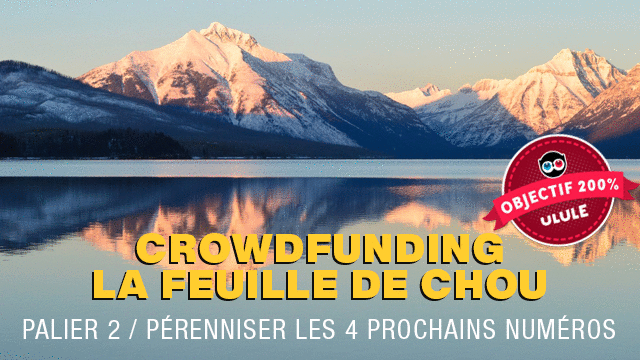Quelle place pour le tourisme sur les sites mémoriels ?
Le mardi 24 juin dernier, un colloque co-organisé par l’IREST, l’UNESCO et plusieurs universités partenaires s’interrogeait sur « Sites mémoriels au patrimoine mondial. Quelle place pour le tourisme dans la définition de la valeur universelle exceptionnelle ?». Á l’écoute des différentes allocutions de la matinée commentant la « mise en tourisme » édifiante d’un monde qui va jusqu’à oublier le sens des lieux qu’il cherche à valoriser, s’est peu à peu esquissée une autre interrogation plus dérangeante : quelle place pour le tourisme sur les sites mémoriels ?

Rue des Cascades@GClastres
La mondialisation du tourisme sur les sites de mémoire
Depuis la fin des années 1990, les pratiques mémorielles explosent, la mémoire est à la mode. Selon Pierre Nora, les sociétés occidentales sont entrées dans « l’ère de la commémoration ». Invitée à s’exprimer sur cette mondialisation des lieux de mémoire, Brigitte Sion, chercheur au Matrice Research Institute, cite l’historien américain Jay Winter et son « memory boom », qui s’est surtout traduit aux Etats-Unis par la multiplication de produits médiatiques ou culturels consacrés à l’histoire[i]. A l’échelle mondiale, elle note l’explosion des lieux de mémoire : musées, mémoriaux, sites commémoratifs, etc. Le mémorial de la Shoah a ouvert en 2005 à Berlin, un Parc de la Mémoire en 2008 à Buenos Aires, un musée- mémorial à Drancy en 2013, un stupa en mémoire des victimes Khmers rouges va être reconstruit dans l’enceinte de la prison S-21 aujourd’hui musée du génocide à Phnom Penh, de nouveaux sites sont également apparus en Uruguay, au Rwanda, en Bosnie, et le musée du 11 Septembre a ouvert le 21 mai dernier à New York.
Or, particularité de l’ensemble de ces espaces dédiés à la mémoire et au souvenir, tous doivent aujourd’hui prendre en compte le fait touristique dès leur conception puisqu’au-delà du souvenir, de la dimension mémorielle, les statistiques de visite montrent que de plus en plus de visiteurs n’ont pas de lien direct avec la tragédie. Et ces nouveaux visiteurs, aussi touristes, influent de plus en plus sur le contenu des sites et des expositions présentées, qui se veulent plus didactiques, explicites, parfois adaptées à des publics plus jeunes, souvent multilingues. Une mondialisation des sites de mémoire qui n’est pas sans poser de questions : comment partager l’espace entre visiteurs et victimes ou descendants de victimes qui n’ont pas les mêmes attentes, comment se recueillir entre les cars de tourisme et les groupes scolaires et donc, au final, comment gérer des cohabitations souvent conflictuelles ?
Brigitte Sion s’interroge sur la nécessité de séparer les visiteurs en fonction de leur motivation. Car, forcément, le tourisme à grande échelle a aussi des impacts sur ces sites, entre le besoin de penser des infrastructures d’accueil (parking, restauration, voire boutique…) et le risque d’être dissonant avec la tragédie évoquée. En outre, ces impératifs pratiques en entrainent d’autres, économiques, puisqu’il faut réussir à entretenir de tels lieux. En mars dernier, l’entrée fixée à l’équivalent de 24 euros pour le musée du 11 Septembre a entrainé toute une polémique. Faut-il faire payer l’accès à un lieu de mémoire ? En outre, le « Souvenir Shop » du musée (pourtant préexistant) – a suscité une vive émotion et posé la question du commerce du souvenir. On pourrait ainsi multiplier les interrogations que suscite cette « mise en tourisme » des lieux de mémoire : faut-il maintenir ces sites en l’état ou les reconstruire ? Les rénover ? Comment éviter les pratiques irrespectueuses, gérer les perceptions différentes du recueillement, du rapport à la mort, de la culture du souvenir, l’ingérence du religieux ? Les défis sont immenses et les enjeux extrêmement complexes et imbriqués car au-delà du lieu de mémoire, il y a en sus toute la dimension architecturale ou « paysagiste» de sites qui devront faire date, être à la fois cimetière et lieu de commémoration, avec pour mission d’inscrire un lieu dans une matérialité qui lui manque. Le lieu devient alors site, la mémoire s’incarne dans du bâti, avec toute la difficulté à représenter l’indicible, la tragédie, l’horreur.
(A suivre)
———————————————–
Suite à la Journée d’étude « Patrimoine mondial et tourisme de mémoire » du 24 juin 2014 qui s’est tenu à la Sorbonne. Chaire UNESCO « Culture, Tourisme, Développement » et EA EIREST, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Université de Cergy-Pontoise
Université Laval, Québec
Université du Québec, Trois Rivières Organisé par
Journée qui valorise aussi un programme de recherche franco/canadien.
Merci à Maria Grabari-Barbas pour l’organisation de la journée.
LES AUTRES ARTICLES DE CE DOSSIER :
Tourisme de mémoire
- Quelle place pour le tourisme sur les sites mémoriels ?
- L'Unesco jusqu'à la lie
Par Geneviève Clastres
Auteur et journaliste indépendante spécialisée sur le tourisme durable et le monde chinois, Geneviève Clastres est également interprète et représentante de l'artiste chinois Li Kunwu. Collaborations régulières : Radio France, Voyageons-Autrement.com, Monde Diplomatique, Guide vert Michelin, TV5Monde, etc. Dernier ouvrage "Dix ans de tourisme durable". Conférences et cours réguliers sur le tourisme durable pour de nombreuses universités et écoles.
Les 5 derniers articles de Geneviève Clastres
- Loomi, la start-up qui simplifie et facilite l’aventure dans les espaces naturels.
- Agathe Clerc : réconcilier tourisme, territoires côtiers et océan
- La Norvège à la voile, c’est possible avec SeilNorge !
- Partir pour une année de césure en Australie
- Persévérance, la science en partage au cœur de l’océan Austral
Voir tous les articles de Geneviève Clastres