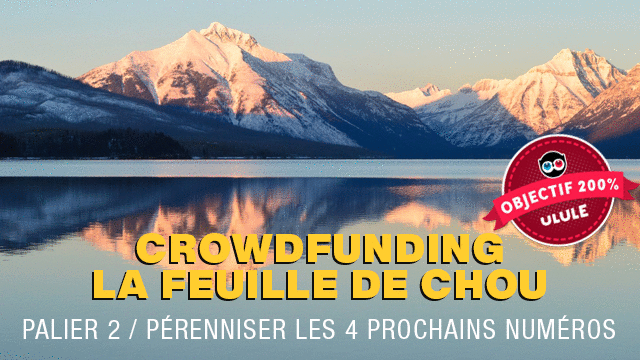Mesurer la performance environnementale, entretien avec Caroline Le Roy !
Thèmatique : Acteur associatif Acteur privé Éducation Innovation Institutionnel Territoire
Office de tourisme, Parc naturel régional, Comité départemental du tourisme, Consulting, Audit, conférences, articles, Caroline Le Roy n’a peur de rien et surtout pas d’enchainer les expériences au cœur de l’écosystème du tourisme. Actuellement sous contrat avec le cabinet Fairmoove Solutions, elle achève également une thèse en Sciences de Gestion qu’elle présentera à la fin de l’année. Son sujet : « Le travail institutionnel des organismes de gestion de destination face à l’anthropocène : le cas des tableaux de bord. » Des réflexions et des études de cas qui seront forcément très utiles aux acteurs du tourisme de demain ; et qui nous ont donné envie d’en savoir plus….

VA / Pourquoi avoir choisi de centrer votre thèse sur la question des « tableaux de bord » et de la « mesure » ? Est-ce une façon de pointer que cela fait encore trop défaut au sein des OGD face aux défis à affronter ?
Suite à mes diverses expériences, j’ai réalisé que travailler sur la dimension environnementale était ce qui m’intéressait le plus, en observant ce qui se passe du côté des organismes de gestion de destination (OGD). Aujourd’hui, la plupart des OGD se préoccupe principalement de leurs chiffres de fréquentation, des budgets, des emplois qu’ils génèrent, tout ce qui a trait à l’économie. En revanche, la durabilité est peu traduite dans les chiffres observés. En outre, si l’on observe les politiques internes, on observe que la part du budget consacrée à l’impact environnemental de l’activité touristique est relativement absent malgré l’engouement des acteurs. Personnellement, je suis une adepte de la théorie du donut qui donne des ordres de grandeur à ne pas dépasser ou à adopter que ce soit sur le front environnemental ou social. Je suis d’ailleurs consciente que le social est le parent pauvre du tourisme mais impossible de tout observer, j’ai dû faire des choix.
VA/ Comment rendre compte de cette dimension environnementale pour un OGD ?
C’est toute la problématique. Comment quantifier ? Mais aussi, quelle est la légitimité d’un OGD pour prendre à bras ces missions si on sort leur mission régalienne. J’ai été attirée par les verrous méthodologiques mais aussi par toutes les questions qui se posent inévitablement. Comment quantifier la perte de biodiversité ? La fragilité des territoires en manque d’eau ? Quelle ingénierie de la donnée ? Quid des données satellites ? Il n’existe pas encore de démarche globale sur la gestion des fréquentations. Il m’a fallu développer de nouvelles compétences, m’intéresser à la double matérialité, aux critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) alors qu’aujourd’hui, l’économique et le financier priment. C’est de l’ensemble de ces constats qu’est parti le centrage de ma thèse : qu’est-ce qu’on fait, avec qui, pourquoi ? En étant conscient que les tableaux de bord ne sont pas uniquement des outils de mesure mais aussi des outils de pilotage sur les ordres de grandeur, les personnes à associer, les parties prenantes, de véritables « usines à gaz » mais nécessaires pour viser une vraie performance qui ne soit pas uniquement économique. Il est quand même incroyable que quand on regarde les missions des OGD dans le Code du tourisme, on constate qu’aujourd’hui encore il invite à la performance mais uniquement sous le prisme économique et financier, l’environnemental et le social restent secondaires.
VA/ Et donc à l’issue des observations réalisées pour votre thèse, avez-vous l’impression que les OGD répondent proactivement aux enjeux environnementaux contemporains à travers l’adoption de nouveaux indicateurs et via de nouvelles pratiques orientées vers une gestion plus systémique des territoires ?
C’est très compliqué vu l’organisation touristique institutionnelle d’être proactif pour un OGD. Je réalise toutefois tout ce que cela nécessite comme ressources, moyens humains, temps, etc. ce qui implique qu’aujourd’hui, les OGD ont plutôt tendance à subir. Plus concrètement, je suis partie sur une métaphore pour situer les OGD quant à leur rapport à l’anthropocène avec pour cadre le triple A : Adaptation, Atténuation, Anticipation. Aujourd’hui, on est clairement plus dans une logique d’atténuation. On tente de réduire l’impact des mobilités, des déchets, de la perte de biodiversité… quand il faudrait anticiper et agir. En fait, cette proactivité existe mais ce ne sont pas les OGD qui s’en emparent et pourtant, dans le Code du tourisme, il est bien spécifié que « l’office de tourisme doit aussi participer aussi à la stratégie de territoire : urbanisme, plan climat, alimentation… » Cela se fait parfois mais ce n’est pas encore bien structuré.

VA / Vous avez opté pour une étude de cas multiple auprès de trois OGD françaises (Biscarrosse, Grand Poitiers, Grand Avignon). Quels seraient les points forts et les points simples de ces destinations au regard de vos analyses ?
De manière globale, grâce à la thèse, aux entretiens et aux réunions, on observe une reconnaissance et un dialogue renforcés entre les Offices de Tourisme (OT) et leur collectivité de tutelle, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). C’est déjà un progrès considérable. Pour les trois OT étudiés, des projets sont soit en cours, soit sur le point de se concrétiser, avec pour objectif de renforcer le lien entre le territoire et l’OT. Ce sont de véritables alliés dans le cadre de ma thèse.
Dans les faits, les véritables enjeux de transition sont aujourd’hui inscrits dans les Plans Climat Air Énergie Territoire (PCAET), ce sont des alliés importants à l’échelle des communautés de communes, et il y a clairement quelque chose à construire dans l’articulation entre tourisme et PCAET. Et pour vous répondre sur les points forts et points faibles des OGD observés, voici quelques éléments ci-dessous sachant que ces trois profils sont complémentaires et s’appuient tous sur les PCAET. A noter également qu’ils font apparaître trois échelles d’intervention différentes : l’accompagnement des pros pour le Grand Avignon (centré les métiers et l’opérationnel), l’OT pour le Grand Poitiers (RSE, SADI et destination d’excellence) et le territoire pour Bisca Grands Lacs (en lien avec les projets de territoire structurants).
Points forts par destination
- Biscarrosse : mise en place d’actions de gestion de crise et travail sur les enjeux d’anticipation (gestion de crise). Il y a également un travail de sensibilisation des habitants sur la question du tourisme durable.
- Poitiers : travail de mutualisation des moyens sur la question de la transition. Des projets vont porter sur le nudge marketing et sur la prospective des métiers dans le cadre d’une démarche RSE.
- Avignon : un important travail a été mené sur la mise en place d’un dispositif de coaching pour accompagner les professionnels dans leur transition. Face aux nombreux doublons entre acteurs, un parcours structuré d’accompagnement des pros a été conçu. En interne, le travail porte sur le design des offres et les mobilités décarbonées.
VA / Pour aller plus loin, et au regard de votre nouvelle expertise, quels outils (tableaux de bord, indicateurs, etc.) ou quelle méthodologie auriez-vous envie de préconiser aux OGD ?
C’est une question compliquée, car il est difficile de vulgariser ce sujet : c’est à la fois très technique et très visuel. Je trouve toujours intéressant de « dézoomer » vers les objectifs du développement durable (ODD), vers les documents territoriaux et les références existantes. Il ne s’agit pas uniquement de travailler avec des indicateurs d’objectif et de résultat, mais aussi de viser des indicateurs d’impact.
Ce qui devient particulièrement intéressant aujourd’hui, c’est la logique de seuil et de fourchette, qui constitue une vraie nouveauté dans la manière d’aborder la performance environnementale. Un point très important qui est ressorti dans le cadre de ces tableaux de bord est la nécessité d’intégrer les parties prenantes. Il y a en effet un vrai travail à mener sur cette question pour les OGD. C’est la base de la RSE : aujourd’hui, on connaît surtout les acteurs du tourisme, mais on ne connaît pas forcément son territoire dans toute sa complexité.
Il faut aussi réfléchir aux parties prenantes invisibles ou invisibilisées. Avec Prosper Wanner, je retravaille actuellement sur ces notions. Un axe que j’aimerais également beaucoup développer est celui du non humain dans les parties prenantes du tourisme : par exemple, le patrimoine naturel ou culturel. Dans les enjeux de gouvernance, cela permettrait d’avoir davantage tendance à les protéger. J’aimerais pouvoir développer des tableaux de bord intégrant le non humain, pour faire en sorte que ces entités puissent « parler » ou être représentées. Au niveau international, des réflexions sont déjà engagées sur ces questions, notamment avec les travaux de la juriste Marine Calmet sur l’intégration du non humain dans le droit.

VA/ Votre thèse vous conduit à conclure que les tableaux de bord pourraient devenir, à l’avenir, de véritables outils de transformation pour les OGD. Pourriez-vous donner un exemple concret, afin d’éclairer un lecteur moins spécialisé ?
Oui, bien sûr. Un exemple très parlant consiste à considérer le tableau de bord comme un véritable outil d’aide à la décision, en utilisant la métaphore de la voiture. Nous travaillons actuellement avec FairMoove sur la création d’un optimum de fréquentation avec l’agence Isère Attractivité en partenariat avec Julie Rieg et Sophie Bonidan. L’objectif est d’observer comment les indicateurs peuvent avoir un impact sur les territoires. Nous nous posons plusieurs questions : à partir de quand cet impact devient-il positif pour les entreprises ? Et pour les habitants ? Nous avons également mis en place une classification des interactions — fortes, moyennes ou faibles — afin de mieux comprendre les effets.
Il s’agit d’évaluer quels effets, positifs ou négatifs, peuvent se répercuter sur d’autres sujets, de manière à ce que le tourisme devienne un contributeur de la santé territoriale. Dans cette démarche, nous intégrons également le concept de Pharmakon (poison, remède, bouc-émissaire) afin d’enrichir l’analyse dans l’outil.
Avec l’Isère, le principe est simple : lorsque le tableau de bord affiche du rouge ou du vert, il s’agit ensuite de formuler des préconisations en lien avec les orientations territoriales, et d’apprendre à partir des données recueillies. C’est une approche très concrète, dans l’espoir que l’outil serve d’aide à la décision plus que de reporting. Toutefois, un problème se pose : le responsable de l’observatoire n’est pas toujours décisionnaire, ni directeur. Cela soulève donc la question de la traduction concrète des résultats dans l’action.
Prenons un exemple : un observatoire peut constater une variation de 2 % de fréquentation par rapport à l’année précédente. Mais par rapport à quoi exactement ? Il faut faire parler le chiffre. En réalité, un chiffre ne parle qu’en fonction d’une volonté politique. Si, par exemple, la Bretagne enregistre une progression de X points, il est essentiel de questionner la conjoncture, la saisonnalité et les actions mises en place, plutôt que de s’arrêter à la donnée brute. Or, les décideurs demandent souvent des chiffres, sans forcément demander d’explication sur ce qu’il y a derrière.
VA/ Pour finir, au-delà des OGD dont vous précisez le rôle clé pour porter la transition, quels acteurs vous semblent aujourd’hui essentiels ?
À nouveau, j’insisterais sur le rôle des PCAET comme alliés, parce que, pour moi, il ne s’agit pas uniquement d’une question de transition. Je trouve également qu’on pourrait aller plus loin en intégrant les avis clients dès l’amont dans les politiques touristiques. Pourquoi ne pas prendre davantage en compte les attentes en matière de consommation, ou encore corréler les études issues de plateformes comme Booking ? Cela permettrait de mieux comprendre ce que les gens attendent en matière de tourisme durable et de voyages “autrement”.

VA/ Justement, « voyager autrement », cela se traduit comment dans les faits ?
À chaque territoire sa réponse. À Arcachon, cela passe par une mobilité décarbonée et une valorisation du patrimoine naturel. C’est exactement ce à quoi s’attendent les visiteurs. En Bretagne, en revanche, les attentes sont peut-être davantage tournées vers la consommation locale. Je trouverais d’ailleurs intéressant de travailler sur ce levier d’attractivité, en associant les politiques touristiques à ce que doit être une destination. C’est d’ailleurs tout le sens des réflexions engagées dans le cadre de l’Agora du tourisme à Bordeaux.
VA/ Pour conclure, quels sont à présent vos projets d’avenir et comment souhaitez-vous poursuivre après cet impressionnant travail de recherche ?
Sur le front de FairMoove, ma priorité est de faire évoluer le Passeport Vert. L’objectif est de capitaliser sur ce que j’ai observé pendant la thèse, en lien avec la reconnaissance de l’ONU. Le Passeport Vert présente certaines limites : il faut l’adapter aux différents types d’OGD (communautaire, départemental, régional, …), tout en poursuivant le projet de déploiement au niveau international, en cohérence avec les travaux menés dans le cadre de la recherche.
Quant à mon travail de chercheuse, je souhaite vulgariser au maximum ma thèse, soit la suite logique de ce travail colossal : répondre à des invitations, participer à des colloques, publier dans des revues académiques. Je vise aussi à amener plus de participatif et à réfléchir à de nouveaux formats plus adaptés au tourisme contemporain. Je m’inscris dans une démarche de recherche spécifique, très partisane, ancrée dans l’action. Je suis à la fois chercheuse, ingénieure, conceptrice de mes méthodes, et j’ai envie d’inviter les OGD à travailler davantage avec les chercheurs. Le tourisme est par définition pluridisciplinaire : géographes, chercheurs, experts de divers horizons ont toute leur place dans les réseaux et ont beaucoup à apporter — et pas seulement sur le plan théorique.
Je vois aujourd’hui des personnes qui mènent une recherche très opérationnelle, perçue comme moins anxiogène ou primitive, à condition qu’elle soit menée de façon un peu active. Ce sont des méthodes très interactives qui permettent d’anticiper plutôt que de subir les conséquences.
Caroline soutiendra sa thèse courant décembre, toute l’équipe de voyageons-autrement.com (dont elle fait partie !) lui souhaite tout le succès mérité !

Par Geneviève Clastres
Auteur et journaliste indépendante spécialisée sur le tourisme durable et le monde chinois, Geneviève Clastres est également interprète et représentante de l'artiste chinois Li Kunwu. Collaborations régulières : Radio France, Voyageons-Autrement.com, Monde Diplomatique, Guide vert Michelin, TV5Monde, etc. Dernier ouvrage "Dix ans de tourisme durable". Conférences et cours réguliers sur le tourisme durable pour de nombreuses universités et écoles.
Les 5 derniers articles de Geneviève Clastres
- « Cartographier les interactions, explorer le rôle de l’espace»
- La ville de Pornichet décroche l’Award d’Argent du programme Green Destinations
- Kourtney Roy illumine la Cité de l’Économie avec ses photographies sur le tourisme mondialisé
- Sur la Piste du Bison !
- C.A.P sur l’écotourisme, un MOOC pour comprendre, apprendre et pratiquer !
Voir tous les articles de Geneviève Clastres
Découvrez nos abonnements
3 voyages sélectionnés par Voyageons-Autrement.com
Informations utiles pour voyager
Voyager TRÈS France avec les membres d’ATR Découvrez l’initiative TRÈS France d’ATR, qui encourage un tourisme bas carbone en France. Grâce à des outils concrets (annuaires, guides, enquêtes), ATR accompagne les...
Vers un écotourisme régénératif : le monde en transition se donne rendez-vous au cœur de la Catalogne Le Global Ecotourism Forum a réuni plus de 400 experts au monastère de Mont San Benet pour définir une feuille...
La Laponie finlandaise au-delà du père noël et des foules voyageuses Explorez la Laponie finlandaise au-delà des clichés du Père Noël. Entre Levi et Äkäslompolo, découvrez un tourisme durable axé sur la nature...
Les escapades nature des Grands Sites de France. Les Escapades nature sans voiture des Grands sites de France accueillent trois nouveaux lieux en 2016. ~ par Mélusine...
Jean-Christophe Victor : sous les cartes… le monde ! « Le dessous des cartes », le livre vient de sortir chez Taillandier (224 p150 cartes 14.90€) ~ par Jerome Bourgine...
Natural Guide au Mali - Voyager Autrement L'équipe du Natural Guide a sillonné le Mali pour dénicher de bonnes adresses, hors des sentiers battus, qui pratiquent un tourisme durable. ~ par Rédaction Voyageons-Autrement...